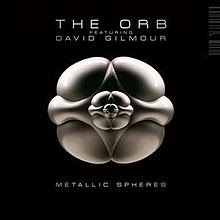Je dis ça parce qu' "on" regardait ça de loin, quand même. Nos amis Brittanniques semblaient n'en plus pouvoir de s'enfiler des pilules de toutes les couleurs et de s'aimer dans tous les sens à l'Hacienda. La Perfide Albion, qui plus est, se trémoussait au son d'un frenchie, Laurent Garnier, faisant pouet pouet avec ses boites à rythme...
Remarquez, on avait déjà pris Jean-Michel Jarre en pleine face, alors celui-là, s'ils voulaient bien se le garder c'était très bien comme ça. Pendant ce temps, on re-découvrait le punk-rock avec les Pixies et Nirvana, enfin un peu de guitare ! C'était pas maintenant qu'on allait se mettre à la techno ! Nous avaient déjà fait le coup des synthés, les British, merci.
Ceci dit, quand même, Joy Division, puis New Order, ça n'avait pas laissé tout le monde indifférent... Alors on écoutait timidement les Happy Mondays, parce qu'un peu pop quand même, mais sans franchir le pas. Avec le sentiment étrange de passer à côté d'un truc, quand même. Finalement, Brian Eno avait réussi la transition entre la musique planante du grand frère et la branchouille arty, via les Talking Heads, par exemple. Mais bon, voilà.
Et parfois, il suffit d'un truc. Le coup de la pédale fuzz sur Satisfaction, encore et toujours elle. Des Pixies qui, quoiqu'on en dise, ne décollent pas, et un Kurt Cobain qui rafle la mise derrière parce que, je sais pas, un meilleur batteur ? Une belle gueule ? Un truc sur lequel rêver. Et franchement, des boites à rythme ça te fait pas rêver. Pouet Pouet.
Et puis sort ce film de fou, Trainspotting, immense, drôle et macabre à la fois, sentant autant la pisse que la bière (ce qui est proche du pléonasme, non ?), dans lequel la musique déglinguée de l'Iguane en période Berlinoise, Lust For Life, quel programme, cotoie ces improbables, Underworld, avec leur Born Slippy. La belle évidence ! Ô le beau cas ! Pas la même soupe, mais le même poison.
Et puis après, l'album. Le deuxième album, Second Toughest In The Infants, Le premier, on l'a tous oublié, Paraît même qu'avant, Underworld était un groupe pop de seconde zone, le cul entre deux chaises, mais là, ils enlèvent carrément les chaises. Bouge, asshole !
Tout ça commence sur les chapeaux de roue, et ces gens-là savaient te faire groover une boite à rythme sans ressembler à des VRP informatiques façn Daft Punk. Quelques voix monochordes là-dessus, c'est pas que ça t'en fait une chanson, mais il se passe quelque chose, on est pas chez les Derrick de la french touch. Ca sent bon le bricolage, ça bouge, c'est neuf, et ça n'est pas du rock'n'roll.
Et la suite à l'avenant, ma bonne dame. On sent dans tout ça l'influence du Floyd, la douce mélancolie des faubourgs chatoyants de Manchester, c'est l'Angleterre de Dickens, celle des petites gens du peuple qui en chient toute la journée, Enfin, après, Joy Division, encore eux, en voilà qui passent le pas, ont le courage de définitivement larguer le schéma rock complètement éculé, et qui laissait trop souvent le goût amer de rester au milieu du gué. Non, ici on danse, mais on a l'ecstasy triste, on sait que le chômage, le SIDA et l'alcoolisme rythment la piste. On achève même les chevaux, comme disait l'autre.
Malheureusement, dès l'album suivant, la messe sera dite, la soupe froide et le réveil brutal. Le boum-boum n'aura plus la même saveur. Et ils seront légion, à tout donner le temps d'un disque, de Leftfield à Propellerheads, ces derniers ayant l'intelligence de jeter l'éponge avant de se planter dans le virage. Un peu comme si, ces nouveaux joujous, moins on savait s'en servir, mieux c'était.
Voilà, des albums techno, j'en poste tous les cinq ans, vous êtes tranquilles pour la suite. Mais celui-ci vaut largement le détour. Les Prodigy et autres Chemical Brothers en feront leurs choux gras, trouvant ici une raison de survivre à la fin morose du vingtième siècle. Pour une fois, ce sont les anglais qui ont entendu des voix...
Confusing The Waitress...